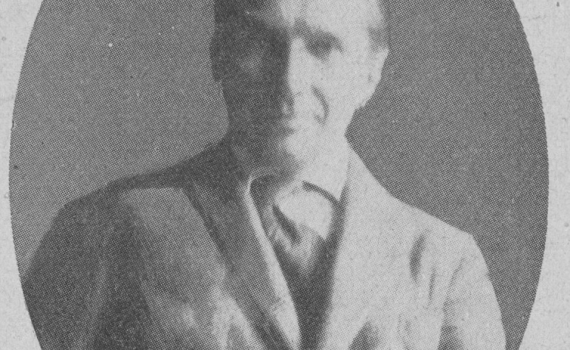
Pourquoi n’y a-t-il toujours pas de première mondiale mise en scène ?
Category : représentations | Auff fr
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Dahms
Hamburg Staatsbibliothek https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN774616555_0016
[pgc_simply_gallery id=”221″]
Walter Dahms a écrit un article détaillé sur l’opéra en 1912.
La raison pour laquelle il n’y a pas encore de représentation complète sur scène (toujours en 2026 !) est décrite ici :
Lorsque j’ai pris en main la réduction pour piano de « Sarastro » de Goepfart, j’ai été choqué par l’audace de son auteur à offrir à notre époque une œuvre aussi incroyablement simple, claire et sans ambiguïté. Certes, cette œuvre a été conçue et créée pour l’anniversaire de Mozart en 1891. Mais les troubles les plus fâcheux (notamment la grande grève des imprimeurs) avaient empêché la représentation prévue à Dresde et à Prague à l’époque. Puis, l’année suivante, il était déjà trop tard. « Sarastro » n’a toujours pas été joué [ note de l’auteur : 1912]. Si cela ne tenait qu’aux Allemands, si mal informés sur leurs créateurs par leurs journaux préférés , l’œuvre pourrait rester injouée jusqu’à la fin des temps . Mais il serait regrettable que le mur d’inertie et de malveillance qu’un journalisme partial et égoïste a érigé entre les esprits créatifs et le public crédule ne puisse être brisé à un moment donné. La tentative serait intéressante, à la fois instructive et prometteuse.
Le drame musical « Sarastro » de Karl Goepfart
Par Walter Dahms
Qui, de nos jours, ne tend pas l’oreille à l’écoute d’une œuvre intitulée « La Flûte enchantée, deuxième partie » ? On parle et on écrit tant de Mozart comme du sauveur de la crise musicale actuelle, comme du guide hors du désert de l’improductivité moderne. « Retour à Mozart ! » s’écriait-on. Weingartner disait : « Non, en avant vers Mozart ! » Quelle que soit l’interprétation, une chose est sûre : le développement de l’art musical et dramatique ne peut jamais consister à « dépasser Wagner », mais le compositeur de théâtre qui souhaite créer quelque chose de rare, de durable et de nouveau doit partir d’un point antérieur à Wagner. Car il existe encore de nombreux chemins inexplorés qui mènent à l’objectif d’un art grand et sublime.
Lorsque j’ai pris pour la première fois la partition pour piano de « Sarastro » de Goepfart, j’ai été frappé par l’audace du compositeur à offrir à notre époque une œuvre aussi incroyablement simple, claire et sans ambiguïté. Certes, cette œuvre avait été conçue et créée pour l’anniversaire de Mozart en 1891. Mais les bouleversements les plus regrettables (et surtout la grande grève des imprimeurs) avaient empêché la représentation prévue à Dresde et à Prague à l’époque. Puis, l’année suivante, il était déjà trop tard. « Sarastro » n’a toujours pas été joué. Si cela ne tenait qu’aux Allemands, si mal informés sur leurs créateurs par leurs journaux préférés, l’œuvre pourrait rester injouable. Mais il serait regrettable que le mur d’inertie et de malveillance qu’un journalisme partial et égoïste a érigé entre les créateurs et le public crédule ne puisse être brisé à un moment ou à un autre. La tentative serait à la fois utile, instructive et prometteuse.
« Sarastro » m’a profondément et durablement marqué dès la première écoute. Je suis revenu à cette œuvre à maintes reprises. Mon intérêt n’a cessé de croître. Voici enfin une œuvre qui visait quelque chose de radicalement différent de ce que les temps modernes aiment et encouragent. Ici, nos émotions humaines primaires ne sont pas destinées à être dégoûtées (comme chez les véristes populaires et leurs disciples allemands) – non, ici, elles sont destinées à être raffinées. Quelque chose de pur, de terre-à-terre, de sain – bref, quelque chose d’allemand – nous parle ici dans une félicité puissante, sentimentale et larmoyante, comme des explosions pathologiques, à la fois verbales et musicales. C’est pourquoi je mets en garde cette œuvre, car j’ai acquis la ferme et inébranlable conviction, en tant que musicien et critique, qu’elle doit également toucher toute personne réceptive à la noblesse.
Tout est symbolique : la lutte entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. La « Flûte enchantée » de Mozart avait également cette tendance. C’était une protestation, compréhensible pour les initiés viennois de l’époque, contre l’inertie, la dépravation et l’oppression des consciences dans tous les domaines . Sans aucune fantaisie humanitaire, elle cherchait à proclamer l’idéal de fraternité humaine universelle. (Cependant, la Révolution française, qui approchait, imposa une dissonance criante à cet idéal – une autre forme de fraternité, mais une autre !). À l’époque, l’objectif était de représenter des personnages purifiés par les épreuves du destin. Le feu et l’eau n’étaient que des symboles. La lutte entre la lumière et les ténèbres, entre Sarastro et la Reine de la Nuit, n’est cependant pas relatée dans « La Flûte enchantée ». Le finale annonce les temps à venir, une époque de luttes et de conflits.
C’est Goethe lui-même qui a conçu et rédigé la seconde partie de La Flûte enchantée, le drame de Sarastro, sous forme d’opéra. L’œuvre de Goepfart, dont le poème a été écrit par Gottfried Stommel, repose sur ce fondement. La continuation de La Flûte enchantée par Goethe était justifiée. Le combat entre les deux forces élémentaires opposées, symbolisées par la lumière et l’obscurité, devait trouver une issue. Le plan de Goethe a fourni les lignes directrices dramatiques à Goepfart et Stommel. La musique de Mozart devait être conservée dans certaines mélodies et motifs à certains moments. Et le résultat devait être conciliant : l’amour devait vaincre la haine. Il était tout aussi nécessaire de mettre en œuvre les idées maçonniques à travers le conflit voulu par Goethe. La justification de la continuation de La Flûte enchantée par Goethe ne fait aucun doute ; on l’affirmera sans réserve et avec joie après avoir constaté la réalisation des objectifs fixés grâce à l’exécution parfaite de l’œuvre de Goepfart-Stommel.
Un examen de « Sarastro » révèle que la structure des actes est porteuse d’un élément distinctif de leur essence . Le premier acte contient l’exposition. Il nous introduit aux différents mondes du drame : celui du bien (Sarastro), celui du mal (la Reine de la Nuit) et celui de l’humanité primitive (Papageno). Après les solennels accords introductifs de l’ ouverture de La Flûte enchantée , le rideau se lève sur l’assemblée des prêtres. Chaque année, ils envoient l’un de leurs frères dans le monde pour témoigner des souffrances et des joies de l’humanité. Le pèlerin terrestre est revenu pur, et cette fois, son destin incombe à Sarastro, leur chef en personne. Il y reconnaît un indice particulier : « La divinité est mise à l’épreuve ! » Il sait qu’une mission grave et grandiose l’attend. L’ancienne ennemie, la Reine de la Nuit, le mal primordial, doit être vaincue. Lui seul en est capable ; car, grâce à sa culture spirituelle supérieure, il perçoit ses intentions, mais elle non les siennes. Une tonalité solennelle et sérieuse imprègne toute cette scène. Des rythmes soutenus, des harmonies claires et des mélodies profondément émouvantes imprègnent la musique. On le voit déjà : « Sarastro » est un opéra vocal au même titre que les opéras de Mozart. C’est d’ailleurs ce qui explique la place particulière qu’occupe l’œuvre dans la littérature lyrique moderne. L’orchestre n’a pas de voix décisive ; il fournit seulement le milieu, le terrain, pour ainsi dire, sur lequel se déroulent les événements (de nature musicale).
La première transformation nous emmène au royaume de la Reine de la Nuit. Un portrait contrasté. Des rythmes entraînants traduisent immédiatement l’agitation mesquine qui règne dans ce royaume. Comme Sarastro, la Reine nous est présentée au milieu de ses compagnons d’armes. Monostatos, le Maure, dont la fille Pamina s’est échappée dans La Flûte enchantée et qui sert et aime désormais sa mère, informe la Reine que la vengeance contre le Royaume de la Lumière bat son plein. L’enfant de Tamino et Pamina, le fils du roi, repose enfermé dans un cercueil doré, dont seul leur pouvoir obscur peut ouvrir le couvercle. Symboliquement : la nouvelle ère est asservie par les esprits apeurés par la lumière. Les hurlements triomphants de la Reine révèlent son opposition profonde au noble Sarastro. Combien son combat contre elle est juste !
La deuxième métamorphose montre Tamino et Pamina, parents soucieux de leur chéri. Les craintes grandissantes de Tamino pour son enfant le poussent à retomber sous l’influence de sa mère, la Reine de la Nuit, qui cherche à le persuader de se venger de Sarastro. Mais cela se révèle tentant pour Sarastro, qui le console en lui promettant la grande mission de l’enfant. Du lyrisme tendre du chœur de femmes, dont le chant accompagne l’incessant transport du cercueil, la musique de la scène de la tentation prend une ampleur puissante et mène au magnifique chœur sacerdotal, primitif : « Qui zèlera contre la lumière ? »
La troisième métamorphose nous présente la vie et les activités d’un peuple naturel et décomplexé, incarné par Papageno et Papagena. C’est là, dans le joyeux brouhaha des enfants, au milieu de la joie et des plaisanteries, que naît Aurore, don des dieux. Elle est l’enfant du peuple, destinée à racheter le fils de la maison princière. Une musique d’une sérénité mélodieuse accompagne cette transformation. Plusieurs mélodies mozartiennes résonnent. Le flux et le reflux de la vie s’écoulent avec vivacité, inépuisable, avec des traits sûrs aussi simples qu’efficaces.
Si le premier acte expose le drame, le second atteint son apogée avec l’explosion des forces hostiles. Fidèle à sa vocation divine, Sarastro poursuit son voyage terrestre. Il y rencontre son vieil ennemi. Le destin des deux forces élémentaires, la lumière et les ténèbres, s’accomplit. La reine ne reconnaît pas le vagabond. Le charme de l’inconnu la submerge et la fait brûler d’un amour ardent pour lui. Elle cherche à le rallier à ses propres desseins, dont le but ultime est la destruction de Sarastro. Il accepte finalement de l’aider à éliminer Sarastro lorsqu’elle jure de libérer Phébus, le fils du roi, du cercueil d’or et ainsi de le ramener à la vie. Sarastro comprend qu’il doit faire des sacrifices pour vaincre la reine et instaurer une « ère nouvelle ». La force éthique de sa personnalité et de ses confessions est merveilleuse. La musique de Goepfart est tout aussi réussie que celle du poète pour construire et exécuter cet acte magistral. Il puise entièrement dans son propre talent, et sa source d’invention mélodique et caractéristique est inépuisable. Avec des traits concis, il traduit les contrastes. Son langage musical est dramatiquement puissant et envoûtant, tout en étant unique et nouveau. Sa confiance dans l’expression des émotions est évidente partout. Il est significatif de voir comment la Reine de la Nuit, dans son triomphe apparent, s’adonne à la colorature pour la première fois dans le drame, comme par nécessité intérieure. Ici, la colorature est véritablement un moyen d’expression, un moyen véritablement nécessaire et apaisant.
Le troisième acte produit des effets inégaux, conséquence de l’accumulation des résolutions nécessaires. Fait rare dans la littérature dramatique, on constate ici que de nouveaux personnages (Aurore et Phœbus), fortement impliqués dans la continuation et la résolution des conflits, n’apparaissent qu’au troisième acte. Ce dernier doit naturellement contenir principalement des motifs mozartiens. Citer Mozart est en partie imposé par les notes de Goethe. Ainsi, Aurora entre avec la musique de glockenspiel de « La Flûte enchantée ». Aucune justification n’est nécessaire, car aucune autre note que celle de Mozart n’est ici perceptible. Dans les différents numéros, Goepfart utilise la forme du rondo musical, fréquemment employée par Mozart. Il devait s’en tenir au style. Il ne faut pas dire qu’il s’est simplifié la tâche en citant la musique de Mozart. Au contraire, il était extrêmement difficile d’adapter sa propre sensibilité au style et à l’esprit de Mozart afin de ne pas laisser l’œuvre entière s’effondrer. Il aurait pu substituer ses propres citations à ses propres inventions. Mais il considérait à juste titre que l’expression de Mozart était la seule possible dans ces passages particuliers.
La première scène nous ramène aux peuples primitifs de la forêt. Ici, Aurore libère Phébus et restitue ainsi à l’humanité le don prométhéen des dieux. L’action culmine avec une scène d’amour des plus intimes entre les deux figures symboliques. S’ensuit une scène burlesque, une sorte de panfest, agrémentée d’une musique de ballet charmante et originale.
La première métamorphose nous montre un aperçu de la vie de cour au palais royal de Tamino. Dames et messieurs se disputent au sujet des dernières nouvelles. Cette dispute stérile prend fin avec l’annonce de la dernière en date : l’entrée du prince Phébus, racheté, et d’Aurore. Ainsi commence le début de la fin. Une nouvelle ère est née. Goepfart a trouvé des tons délicieux pour les conversations des courtisans, des tons qui révèlent en lui un maître de l’humour musical.
Une transformation ouverte mène au final. C’est ici que les contrastes les plus saisissants apparaissent entre la joyeuse jubilation à l’entrée du jeune couple princier et la douleur des prêtres à la mort de Sarastro. Ces deux scènes ne pouvaient être représentées qu’avec des motifs influencés par Mozart, avec le chœur jubilatoire du final de La Flûte enchantée et la Musique de Feu et d’Eau en do mineur. Au fil de l’action, notamment avec l’arrivée de la Reine de la Nuit, qui semble également célébrer victoire et jubilation, Goepfart a trouvé ses propres accents, très caractéristiques. L’action se transforme en catastrophe. La Reine exige de voir son ennemi mort : « Et si mon royaume tombait en ruine ! » Tamino la conduit au sarcophage de Sarastro. Reconnaissant le vagabond dans le cadavre, elle s’effondre, inconsciente. Pendant ce temps, « Ô Isis et Osiris », mélodie immortelle de Mozart, résonne à l’unisson parmi tous les prêtres, jurant de continuer à œuvrer dans l’esprit de Sarastro même après sa mort. Bouleversée par la terrible prise de conscience (de sa propre défaite), la reine exprime le désir passionné de s’unir au sublime lien de l’amour, mais les prêtres la rejettent avec indignation. Dans son angoisse, elle implore Sarastro, son ennemi et ami, transfiguré, de lui donner un signe de réconciliation et de l’accomplissement de son souhait. Cela se produit. Un génie apparaît, touche la reine de la paume de la paix et la conduit au royaume de la paix éternelle. Sarastro et la reine apparaissent unis sous le dôme – l’amour a vaincu la haine. Grâce à lui, tout mal est éradiqué. La famille régnante et le peuple se joignent alors au chœur jubilatoire de la libération par l’amour, avec une exaltation toute différente.
« Sarastro » de Goepfart-Stommel se révèle être une œuvre empreinte d’une intention éthique et d’une volonté pure et profonde. Cette capacité à suivre le rythme de la volonté est indéniablement manifeste dans la poésie et la musique. Les maisons d’opéra allemandes doivent veiller à ce qu’une œuvre aussi sérieuse et magnifiquement accomplie ne manque pas de succès. Il est de leur responsabilité de mettre en lumière une œuvre qui, par sa noblesse d’esprit, par la simplicité et la puissance de sa conception et de son exécution, se distingue de la moyenne, une œuvre qui, par sa simplicité et sa vérité intérieures, occupe une place exceptionnelle dans la création contemporaine et qui, j’en suis fermement convaincu, laissera toujours une impression profonde et durable. La scène allemande, qui s’ouvrira avec « Sarastro » de Goepfart, aura la réputation d’une véritable prouesse artistique.